Se prononce aussi: Comment t’épelles « théorie du genre »? / de quoi ça parle l’article? / tu peux ré-expliquer, mais en mieux, en vite et avec des images?
Contexte: « Salut miss, je travaille sur un projet pour lequel je vais être payé et j’ai besoin de pomper ton travail gratos, t’aurais une 3 journées max à m’accorder? »
Bon avant toute chose, rien que d’avoir écrit « salut miss » je me sens sale. Jamais. Tu m’entends? Jamais t’appelles une meuf comme ça. On en peut plus. Bon, passons à nos moutonneries, à savoir la seule attitude qui te permet de revendiquer à la fois une arrogance éhontée, et une auto-infantilisation assumée, j’ai nommé : l’injonction à la pédagogie, AKA « mais pourquoi, comment, de quoi, mais si tu m’expliques pas je fais comment moi », AKA « je suis tellement prêt à admettre l’étendue de ma flemme, mais aussi mon incapacité absolue à être autonome et mon besoin à peine refoulé qu’on s’occupe de moi non stop que je ne vois pas d’autre solution que tu me moulines finement et me nourrisses à la petite cuillère de tout ce que je suis pas foutu de chercher moi-même, car je te perçois comme étant low-key à mon service ».
J’veux pas être désagréable, mais : et ta dignité dans tout ça ?
Le problème avec cette attitude, c’est que la personne qui s’apprête à prendre du temps pour te prémâcher l’info que t’as la flemme de chercher et que tu vas pouvoir ressortir telle quelle à ta prochaine réunion pour avoir l’air so woke, elle a travaillé en fait. Elle a lu, elle a discuté, elle a relu, elle s’est plantée, elle a retenu, elle a confronté, elle a synthétisé, elle a fait des liens, elle a bossé. Alors oui, je comprends bien qu’on a chacun·e nos priorités, notre temps, nos appétences et nos compétences. Mais on a aussi chacun·e nos limites et là c’est plus possible.
« Mi oui mi alors nous on fait quoi nous alors? » Comme je te sais désemparé (c’est tout le sujet de cet article), laisse-moi te fournir 6 conseils beauté pour ton âme en perdition, quand te vient l’envie de pas faire le taf toi-même.
Conseil n°1: Fucking Google it
Des sabots qui frappent, des éperons qui tintent : mais oui ma parole, c’est bien toi que j’entends, monter sur tes grands chevaux. « Si VoUs NoUs ExPlIqUeZ pAs, C’eSt SûR oN rIsQuE pAs De CoMpReNdRe HeIn ». Et bien tu vois mon chaton, c’est là ta première erreur. Confondre la matière qui va t’éduquer et l’action de t’éduquer, pour laquelle tu fais pourtant preuve d’une autonomie remarquable quand il s’agit de savoir c’est quand qu’ça reprend Koh-Lanta. Mais utiliser Google tout seul comme un grand pour t’informer sur « le truc de l’écart des salaires là », t’as 2 ans et demi, t’as jamais vu un smartphone et t’as besoin d’assistance.
Te rends-tu compte de l’attitude de crevure que c’est d’exiger d’une catégorie de personnes que tu désignes depuis ta chaise haute qu’elles prennent le temps de te prémâcher, puis de t’expliquer des choses que tu peux trouver par toi-même ? Du comportement puéril que c’est d’exiger que l’info vienne à toi, plutôt que l’inverse ? Parce qu’une fois que tu acceptes de faire ce pas insoutenable de prendre en charge ce que tu peux de ta propre éducation, la matière, elle est là. Elle est gigantesque, elle est variée, elle est accessible, et bien souvent gratuite (j’y reviens, t’inquiète que j’y reviens).
Step one: Internet est peuplé de meufs que t’insultes ou, la version « mec bien », à qui tu vas gentiment expliquer qu’elles s’y prennent pas comme t’aimes bien, bah tsais quoi ces meufs là, à la place, tu les lis. Tu prends sur toi, tu ranges ta petite casquette à hélice de critique littéraire des zinternettes et ton petit rictus arrogant par défaut, et tu la lis juste.
Step two: Et puis quand tu t’es un peu chauffé, tu vas voir que des espaces pour s’éduquer à pas agir comme un malappris, y’en a plein. Il y en a pour tous les niveaux, tous les médias, tous les âges. Tu sais, celle que tu as lue en serrant les dents, et bien tu suis les comptes vers lesquels elle renvoie. Tu suis les comptes que suivent les comptes vers lesquels elle renvoie.
Step trois: De là, mode fusée, tu t’abonnes aux blogs. Tu achètes un livre. Y’a même des BD féministes. Y’a des magazines aussi, et de la science-fiction, et des podcasts. Y’a des chaînes Youtube, des comptes Insta, Twitter, TikTok, des humoristes, des journalistes, des biologistes, sociologues, artistes. Y’a des pages wikipédia, des docus, des collages, du slam, des performances. Y’a des séries, des films, des thèses, des fanzines.
Je vous voir déjà venir avec vos petits noeils tout mouillés de larmes : « Oui mi ça veut dire qu’on peu pu rien chamais demander alors? » Disons juste qu’il y a un gouffre entre « ton avis m’intéresse pour ci » ou « t’aurais une ref pour que je comprenne mieux ça » et « raconte-moi Simone de Beauvoir ». Franchement si tu commences par Googler tes questions, mais le GAIN de TIME. Pour nous, j’entends. Et à force on aura même l’impression que tu nous respectes un peu dis donc.
Conseil n°2: Grow up
Sous un partage d’un de mes articles, j’ai pu lire ce pertinent apport à la réflexion collective, je cite : « Des grands « FaUt EdUquEr lEs HomMes » mais quand il faut faire du renforcement positif y a plus personne. Quand ton gosse fait un truc « normal » pour la première fois tu fais aussi « ouaaa c’est normal en fait, t’as cru j’allais te féliciter » Ben oui grognasse c’est comme ça qu’on fait, personne a dit que c’était exceptionnel mais faut faire croire que oui pour « éduquer » ».
Bon. Passons sur le présupposé qu’on a d’office un « mon gosse » à qui refuser notre affection. Passons aussi sur la fragilité de l’usage de l’insulte comme véhicule de frustration – nous pourrons parler une autre fois de façons de solidifier son argumentation même lorsqu’on se sent inférieur et/ou en difficulté. Allons à l’essentiel: l’argument consiste bien à assimiler l’apprentissage des questions féministes à l’éducation des enfants. Je vais un peu marcher sur des œufs sur ce coup-là mais… Avez-vous conscience d’être… des grandes personnes ? Nan parce que l’argument « dur dur d’être bébé » (c’est son nom scientifique, qu’est-ce j’y peux) est un motif récurrent dans tout votre attirail du « meilleur allié ».
Mais si, regarde: vous l’utilisez aussi quand des hommes disent ou font de la merde antiféministe et sexiste. Combien de fois on entend, après qu’un homme ait dit un truc de merde, ou agressé sexuellement quelqu’un·e, que c’est une erreur de jeunesse. Excuse qui marche, d’après mes calculs, jusqu’à au moins 30 ans. À cet âge-là nous on est priées d’avoir deux enfants élevé·es au grain de l’éducation positive et de maîtriser la pâte à choux tout en étant à un point raisonnablement ambitieux de notre carrière.
C’est d’ailleurs particulièrement cocasse (c’est un code name pour « c’est un foutage de gueule sans nom ») de noter que 1/ceux pour qui on brandit l’erreur de jeunesse peuvent à la fois plaider la maturité, ça n’est apparemment pas incompatible et 2/ quand l’immaturité des hommes les prémunit à la fois de la nécessité de s’instruire et de tenir des propos décents, c’est la même immaturité qui est utilisée pour expliquer le militantisme des féministes (tsais le « tu dis ça parce que t’as pas encore assez vécu »). Et me lance même pas sur la maturité à géométrie variable impliquant que les mecs sont d’éternels ados, tandis que les filles sont sexualisables le plus tôt possible.
Bref, je trouve ça personnellement très drôle que tu admettes avec tant de fougue ton droit à être considéré comme un gros bébé. En revanche, je te saurai gré, s’il te plaît bien, d’admettre que ta requête ne s’encombre aucunement de cohérence à partir du moment où l’immaturité devient une porte de sortie ou un fardeau en fonction de qui la brandit. Thank yeeew.
Conseil n°3: notre expertise n’est pas un dû
Tu sais que pour une majorité d’entre nous, le militantisme c’est pas un métier hein ? On touche pas 500 boules dès qu’on va faire une manif. Je touche pas de salaire autrement qu’en cœurs avec les doigts pour écrire mes articles. Quand je suis chercheuse, bloggueuse, mais aussi collègue, amie, amoureuse, casseuse-d’ambiance-en-soirée, je fournis un travail gratuit.
Je réponds à des questions que se posent mes proches, je fournis des pistes de réflexion qui me semblent appropriées, je cherche des références qu’on me demande « comme ça vite fait », j’absorbe les regards qu’on me lance et qui disent « bah tu réagis pas? », je gère comme je peux les débats dans lesquels on me tire par la manche sans me demander si j’ai envie de débattre, je réagis comme ça se met quand on me « taquine » à coups de blagues sexistes, je réponds poliment quand on me demande si j’ai lu tel livre et si je peux « le résumer, mais très rapidement ». Tout ça, c’est du travail gratuit. Je dis pas que c’est mal, je dis pas qu’on me force, je dis juste que c’est gratos.
C’est aussi le cas de la meuf que tu connais là, qu’est féministe extrémiste. C’est le cas de toutes les meufs qui ont un jour pas ri à une blague sur Dutroux, ont été cataloguées en conséquence, et sont devenues sans avoir rien demandé les féministes de service qu’on somme de réagir au moindre comportement sexiste. C’est le cas des personnes non-binaires, qui doivent expliquer 100x leurs pronoms, pourquoi, comment. C’est aussi le cas de la meuf noire que tu es vraiment, sincèrement, holala tellement désolée d’avoir visiblement blessée, mais que c’était pas ton intention, donc tu comprends pas, donc va quand même falloir t’expliquer pourquoi elle a si mal réagi, merci bien.
Et tu vois, elle est là la limite. La ligne de démarcation entre ce qu’on est chacun·e prêt·e à fournir, un jour donné, de notre plein gré, et ce que toi, tu attends, tu exiges de nous. Cette ligne, c’est nous qui la fixons, pas toi. Ou plutôt, toi tu la fixes pour toi-même, pas pour les autres, iels s’en chargent. Elle est là, l’injonction à la pédagogie: quand tu pars du principe qu’on bosse toustes pour toi, gratuitement qui plus est. Que ce qu’on fournit n’est pas suffisant, que tu en exiges toujours plus, parce que bon, après tout c’est pas toi qui les demandes hein, tous ces droits. Mais à quel point faut avoir sa tête loin dans son cul bordé de privilèges. Soit tu décides que ça ne te concerne pas, et tu dégages de nos luttes. Mais alors pour du vrai. Soit tu te dis que ça t’intéresse, et ça c’est vraiment top, mais alors tu fais ta part.
Tout ce travail existe parce qu’on le fait exister, parce qu’on veut transmettre, parce qu’on veut se décharger, parce qu’on en pleure, parce qu’on en crève. Ta théorie, c’est nos vies. J’adore écrire, ça me fait du bien, c’est cathartique et réjouissant, mais c’est aussi pénible et enrageant de produire du contenu toujours d’actualité sur ma propre oppression et celle des personnes qui m’entourent. Donc que tu penses qu’on te doit quoi que ce soit, même après qu’on t’ait donné quelque chose qu’on ne te devait pas: mais en quel honneur stp?
Conseil n°4: I can teach you, but I have to charge
[Cette section comprend 10 liens vers mon Tipeee tout-frais-tout-beau sur lequel je t’invite cordialement à me doucher de thunes à coup de 3€: sauras-tu tous les retrouver?]
Une façon efficace de nous proposer de passer cette fameuse ligne de démarcation, c’est les sous. Récemment, j’ai donné mon avis sur un truc (I mean, duh…). J’ai dit sur Facebook tout ce que je trouvais problématique dans une production culturelle qui venait de sortir. Et là, surprise, l’une des personnes en charge du projet commente ma publi, me demande des éclaircissements, me propose qu’on en discute avec l’équipe parce que bon, tu vois, mon avis il était quand même fort pertinent. Je dis « avec plaisir pour en parler, je reviens vers toi avec mes tarifs ». Et là tout d’un coup mon avis est passé de « bloquons une après-midi avec toute l’équipe pour discuter » à « ah ouais non, malentendu, byyye ». QUOI LE FUCK J’AI ENVIE D’DIRE. À croire que le problème n’est pas la pertinence de mes arguments.
Soyons limpides : tu as le droit de pas vouloir de mon expertise. Tu as aussi le droit de pas vouloir me donner tes sous. C’est avec les deux en même temps que j’ai du mal. On parle bien 1/ de skills ou d’infos 2/ que tu n’as pas, 3/ que tu veux avoir. Et ça tombe bien dis donc, nous aussi y’a quelque chose que t’as qu’on veut avoir. La pédagogie est un travail, le partage de connaissances est un travail, la diffusion de savoirs est un travail. Quand c’est possible, on veut bien des sous, oui. Ni la visibilité, ni ton éveil intellectuel ne sont acceptés contre des Panzani. On veut du cash.
Mais je sais bien, on est pas censées expliciter ce truc-là. Quand on fait autre chose que chuchoter notre féminisme on nous demande de nous calmer, mais dès qu’il s’agit de vouloir être payées, soudainement on attend de nous qu’on se nourrisse de la pureté de notre militantisme et qu’on s’abreuve de la puissance de nos convictions et qu’on se fringue avec quoi, le swag de nos arguments ?
Parce que comme toutes vos maudites injonctions, on se retrouve bien souvent entre deux impasses: soit on bosse gratos et on peut oublier le luxe du beurre frigotartinable, soit on est payées et on est des suppôts du système qu’on dénonce, et comment ose-t-on avoir besoin de s’alimenter alors qu’on se permet de critiquer le capitalisme patriarcal blanc? C’est oublier un peu vite que dénoncer un système ne nous fait pas pousser une capacité magique à nous extraire dudit système. Le système capitaliste il s’en fout que je le dénonce ou pas: il existe et je vis en plein dedans. Lutter prend du temps et de l’énergie. On doit payer des trucs. Donnez-nous vos sous.
T’as pas idée à quel point ce truc est récurrent. On fournit un travail conséquent, gratuit, de qualité, de notre plein gré. Parfois, notre travail est utilisé sans même qu’on nous cite. En règle générale, on est invité·es à parler de nos luttes, sans être payé·es. Des fois, d’autres se font de la thune en pompant notre taf gratuit. Souvent, on nous regarde avec des yeux ronds quand on explique que ouais, non, j’ai pas juste téléchargé les autrices féministes, je les ai lues; j’ai pas sucé mon cadre théorique de mon pouce, je l’ai bossé; j’ai pas trouvé mon analyse dans les plis du canapé, je l’ai construite. Et malgré tout ça, souvent y’a toi, qui es là à trouver que ce qu’on produit, c’est entre normal et pas suffisant. GOD DAYUM, ce bagout.
Alors attention, il s’agit pas, en toutes circonstances, de conditionner l’accès à notre travail au fait d’être payées. Pour le dire autrement, que tu me donnes tes sous ou pas, mes articles te sont accessibles gratuitement. C’est que donner ses sous est une façon étrangement négligée d’utiliser ses privilèges qui, pourtant, se traduisent souvent directement sur le plan de la sécurité financière. Or payer les associations, les militant·es, les productions, les caisses de grève, les fonds de soutien, etc. est une manière productive de soutenir celleux qui portent les causes en lesquelles on croit, et qu’on ne sait pas toujours comment porter soi-même.
Y’a rien d’obligatoire, et ça n’est pas non plus un passe-droit pour être une raclure-parce-qu’on-file-ses-sous, mais c’est une manière absolument sensée et nécessaire d’utiliser ses privilèges, que je te laisse le soin de comptabiliser pour toi-même. En d’autres mots, on a chacun·e nos leviers, de nature et de degré variables. Pour certain·es d’entre nous, ces leviers incluent l’apport financier, négligé bien que crucial voire vital pour certaines causes (je pense par exemple aux caisses de soutien aux travailleur·euses du sexe en plein confinement).
Conseil n°5: Dépasse ta flemme
Ta zone de confort te semble grande, mais c’est juste parce qu’elle t’est facilement accessible. Elle t’est donnée partout, tout le temps, au point que t’as cru que tu apprenais très efficacement, que tu supportais tout, que t’étais blindé face à la contradiction, que ta consommation culturelle était extrêmement diversifiée, que tes connaissances étaient variées et contradictoires et transversales, comme ces gens qui répondent « de tout » quand on leur demande ce qu’iels écoutent comme musique. Mais en fait, t’as un monde à découvrir, le tien te semble universel uniquement car il est aussi dominant que toi. Category is: egotrip extranvaganza. Y’a un million de choses qui t’échappent pendant que t’es là, la bouche ouverte, à attendre qu’on fasse l’avion avec tout le savoir féministe qui se déploie partout.
Du coup, le prends pas mal, mais t’es logiquement plus paresseux. Tu dois faire aucun effort pour chercher l’info qui te parle, le personnage qui te ressemble, l’œuvre qui est écrite pour toi. Alice Coffin a payé le prix fort pour avoir relevé une réalité pourtant si simple et juste, et qui traverse tous les systèmes de domination: en tant que blanc·hes omniprésent·es dans les représentations, on se sent rejeté·es dès qu’un film compte plus d’un personnage noir, comme s’il était inconcevable d’universaliser ces vécus-là. En tant que personnes cis, on applaudit quand une série compte un personnage trans, mais faudrait pas que ça devienne une habitude, ni que ça prenne du travail aux acteurices cis-qui-peuvent-vraiment-tout-interpréter-c’est-leur-métier-après-tout. En tant qu’hétéro, on est tout déstabilisé·es quand un personnage lesbien est autre chose que juste lesbienne dans son arc narratif. Comment ça, elle a aussi un travail? Il est trop compliqué ce personnage, on comprend rien.
Là je te parle de personnages fictifs, mais ça vaut pour les auteurs dont t’as entendu parler à l’école, pour les journalistes que tu suis, pour les romanciers que tu lis, pour les politiciens, les chanteurs, les penseurs, les scientifiques, les profs, les présentateurs, les artistes. Je te laisse envisager tout·e seul·e de combien de systèmes de domination tu bénéficies, et de quelle façon ça impacte ton accès à tout ce que je cite ici.
Nous on est abreuvées de toi. L’inverse n’est pas vrai. Pour nous abreuver de nous-mêmes, depuis toujours, on a dû chercher, travailler, fouiller, être curieux·ses et rester alertes. Toi pas. C’est OK, mais apprends à le faire plutôt que monter sur notre dos pour profiter de nos habitudes. Ca nous allègera.
Conseil n°6: Reconnais la pédagogie
L’injonction à la pédagogie a aussi ceci d’agaçant: soit, même quand tu dis explicitement que tu vas pas faire de pédagogie, t’as toujours une trentaine de branques qui viennent te quémander des arguments, soit elle vient se superposer à une situation qui est déjà une situation de pédagogie. C’est-à-dire qu’on se retrouve régulièrement à se prendre des exigences de pédagogie alors qu’on est déjà en train de fournir ce travail. Mais pas de la façon que tu veux.
Ah mais ouais parce qu’il suffit pas de faire de la pédagogie, faut le faire gentiment aussi. En vous faisant des petites doudouces sur la tête comme ça, et si possible en ASMR. Et si possible en porte-jarretelles. Et que ce soit pas trop long, surtout. Ni trop compliqué. Et que ça aille dans ton sens, idéalement. Et beaucoup de douceur, ça c’est important. Si c’est drôle, c’est un plus. Puis faut qu’il y ait un happening dans chaque virgule pour garder ton attention. Ou alors tout ludifier, si y’a pas un coefficient Bois-des-rêves à chaque phrase, ça vaut pas la peine.
Mais l’épuisement, chaton! T’as cru que les spas restaient ouverts en pandémie pour les militant·es ou bien? Quand on t’explique notre point de vue, c’est de la pédagogie. Quand on parle de notre vécu, c’est de la pédagogie. Quand on argumente, c’est de la pédagogie. Quand on te dit qu’on n’en peut plus de tel débat, c’est de la pédagogie. Ce que tu lis ici, c’est de la pédagogie. Que tu sois d’accord avec le propos ou pas. Que tu te sentes visé ou pas. Ca n’a aucun lien.
Donc venir poser 15 questions parce que t’aimes pas le ton utilisé, ou « jouer l’avocat du diable », ou forcer le débat, ou péter un câble dès que la personne en face à pas envie de débattre avec toi, ou utiliser les mêmes arguments que t’utilisais y’a 3 ans sans avoir bougé tes curseurs de 3mm depuis, c’est pas une super nouvelle sur ta capacité à apprendre en fait.
S’informer fait partie de ton devoir politique. Et pour tout te dire (c’est malin de balancer ça maintenant tu vas m’dire) je pense aussi qu’il est du devoir politique des militant·es d’éduquer. Sauf qu’en vrai, on le fait. Genre, beaucoup. Avec passion, plaisir, ou méga flemme, dans un cadre formel, ou informel, contre rémunération, ou agressivité, ou marques d’intérêt, tout en colère, ou douceur, ou clarté ou conceptualisation. My point c’est que transmettre ce qu’on sait, on le fait. Ce qui va pas c’est quand tu l’exiges. Quand tu peux pas entendre que c’est pas le moment. C’est quand demander qu’on te fournisse notre travail est ta seule façon d’apprendre. À un moment y’a pas 1000 chemins, va falloir que tu sortes, ou que tu travailles. Et please posez vos questions, please osez dire quand vous savez pas, please entendez aussi quand nous on sait pas, ou quand on n’est pas OK de répondre, et puis entendez quand on sait, en fait. Mais glander à chaque tournant, bouche en coeur, caprisun à la main, à attendre qu’on te porte pendant que tu brandis fièrement ton écusson féministe, juste non.




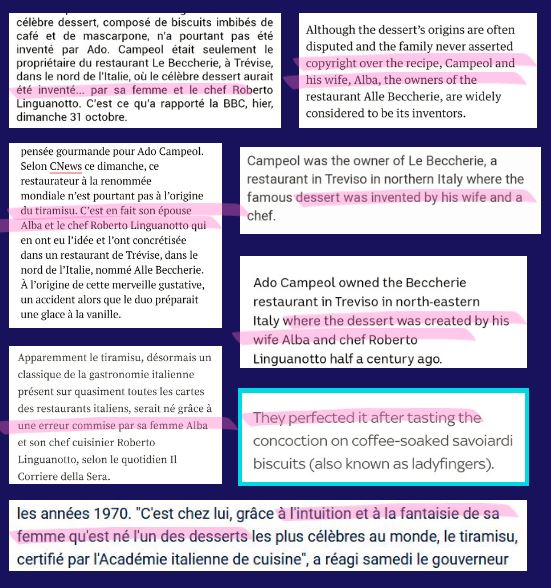















Vous devez être connecté pour poster un commentaire.